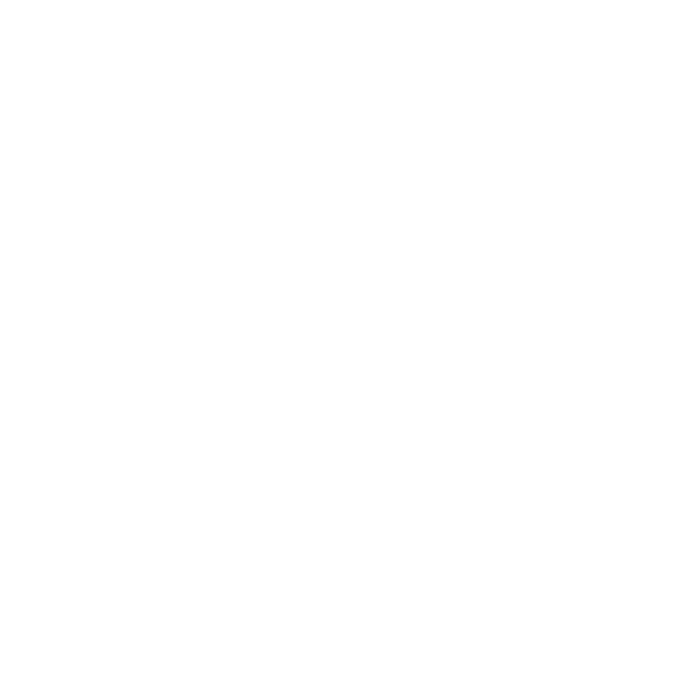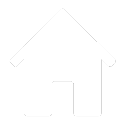Transmission de l’hépatite B : comprendre les voies de contamination
Qu’est-ce que l’hépatite B ?
L’hépatite B est une infection virale causée par le virus de l’hépatite B (VHB). Ce virus s’attaque principalement au foie et peut entraîner une inflammation aiguë ou chronique de cet organe. Dans certains cas, l’hépatite B peut évoluer vers des complications graves telles que la cirrhose ou le cancer du foie. Le virus est extrêmement infectieux, environ 50 à 100 fois plus que le VIH. C’est pourquoi la transmission de l'hépatite B constitue un enjeu majeur de santé publique à l’échelle mondiale.
Modes de transmission de l’hépatite B
La transmission de l'hépatite B s’effectue par contact avec du sang, du sperme, des sécrétions vaginales ou d’autres fluides biologiques d’une personne infectée. Contrairement à certaines autres hépatites, le virus B n’est pas transmis par l’alimentation ou l’eau.
Transmission par voie sexuelle
C’est l’un des modes les plus fréquents de transmission de l'hépatite B, notamment chez les adultes jeunes. Le virus peut être présent dans le sperme, les sécrétions vaginales et le sang. Il suffit d’un rapport sexuel non protégé avec une personne infectée pour être contaminé. Cela inclut les relations vaginales, anales et orales. Le risque est plus élevé en cas de lésions ou de saignements des muqueuses.
Transmission par le sang
La transmission de l'hépatite B par le sang est particulièrement préoccupante. Elle peut survenir dans les situations suivantes :
- Partage de seringues ou de matériel d’injection chez les usagers de drogues
- Matériel de tatouage ou de piercing non stérilisé
- Contact accidentel avec du sang contaminé, notamment chez les professionnels de santé
- Utilisation de matériel médical ou dentaire non désinfecté dans certaines régions du monde
La transfusion sanguine est aujourd’hui très sécurisée en France, mais elle reste une cause possible dans les pays où le dépistage du sang n’est pas systématique.
Transmission périnatale (mère-enfant)
La transmission de la mère à l’enfant au moment de l’accouchement est une voie fréquente de transmission de l'hépatite B dans les pays où la maladie est endémique. Le nouveau-né peut être contaminé au moment du passage dans le canal vaginal si la mère est porteuse chronique du virus. C’est pourquoi un dépistage systématique est proposé à toutes les femmes enceintes en France, afin d’initier une prévention néonatale immédiate (vaccination et immunoglobulines dès la naissance).
Transmission par contact familial ou professionnel
Le VHB peut également être transmis dans un cadre domestique ou professionnel lorsque des objets coupants ou tranchants sont partagés (rasoirs, brosses à dents, coupe-ongles). Le risque est accru si l’un des membres du foyer est porteur chronique. En milieu professionnel, la transmission de l'hépatite B peut concerner les professionnels de santé, de secours ou d’aide à la personne en cas d’exposition à du sang ou des piqûres accidentelles.
L’hépatite B est-elle transmissible par la salive ?
Le virus peut être détecté dans la salive, mais en faible quantité. Le risque de contamination par un baiser est considéré comme négligeable sauf en présence de lésions dans la bouche ou de saignements. Le partage d’ustensiles (couverts, verres) ne constitue pas un mode de transmission de l'hépatite B identifié. Il est donc peu probable qu’un contact social ordinaire, comme une poignée de main ou un câlin, entraîne une contamination.
Période d’incubation et contagiosité
La période d’incubation du virus est de 45 à 180 jours. Durant ce laps de temps, la personne peut être contagieuse, même en l’absence de symptômes. Le virus est présent dans le sang bien avant l’apparition de signes cliniques. La contagiosité est maximale durant la phase aiguë et dans les cas chroniques avec forte charge virale.
Groupes à risque de transmission
Certaines populations sont plus exposées à la transmission de l'hépatite B :
- Usagers de drogues injectables
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)
- Partenaires sexuels multiples
- Personnes originaires de zones à forte endémie (Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est)
- Professionnels de santé
- Détenus ou personnes incarcérées
Ces groupes bénéficient souvent d’une surveillance accrue et de recommandations vaccinales spécifiques.
Prévenir la transmission de l’hépatite B
Vaccination
La vaccination reste le moyen le plus efficace de prévention contre la transmission de l'hépatite B. Elle est recommandée en France pour tous les nourrissons depuis 2018, ainsi que pour les groupes à risque. Le schéma vaccinal comprend généralement trois injections réparties sur six mois.
Précautions universelles
Le respect des précautions standards en milieu de soins (gants, désinfection, aiguilles à usage unique) est essentiel pour prévenir les contaminations professionnelles.
Préservatif et comportements à risque
L’usage du préservatif lors des rapports sexuels est fortement recommandé, notamment avec des partenaires dont le statut sérologique est inconnu. Il convient également d’éviter le partage de seringues, de matériel de rasage ou de manucure, et de privilégier les professionnels déclarés pour les tatouages ou piercings.
Que faire en cas d’exposition ?
Une personne exposée à un risque de transmission de l'hépatite B (piqûre accidentelle, rapport non protégé, etc.) doit consulter rapidement un professionnel de santé. Selon la situation, un traitement post-exposition (vaccin et immunoglobulines spécifiques) pourra être administré dans les 48 heures.
Cas particulier : co-infections et IST
Il est fréquent que le virus de l’hépatite B soit contracté en même temps que d’autres infections sexuellement transmissibles, comme le VIH, la syphilis ou l’hépatite C. C’est pourquoi un dépistage large est souvent proposé en cas de comportement à risque. Certaines co-infections peuvent accélérer la progression de la maladie hépatique, ce qui justifie une prise en charge rapide et coordonnée.
Se protéger, se faire dépister
La transmission de l'hépatite B reste une réalité, en dépit des campagnes de vaccination et des moyens de prévention disponibles. Parce que le virus est très infectieux, la vigilance est de mise, notamment en cas de comportements à risque. Le dépistage est la seule façon de savoir si l’on est porteur. En cas de doute, il est important de consulter un professionnel de santé ou de se rendre dans un laboratoire d’analyses médicales.
Liens utiles vers le glossaire santé sexuelle
Pour mieux comprendre l’hépatite B et les autres infections sexuellement transmissibles, consultez aussi :
- Symptômes hépatite B
- Complications hépatite B
- Prévention hépatite B
- Dépistage IST sans ordonnance
- Glossaire IST MST
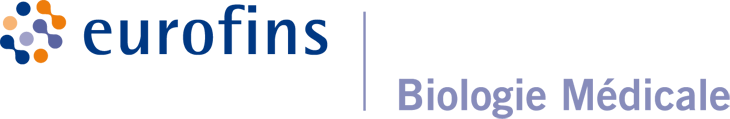
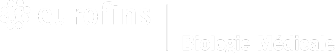
 Patients
Patients
 Professionnels
Professionnels
 Fertilité
Fertilité