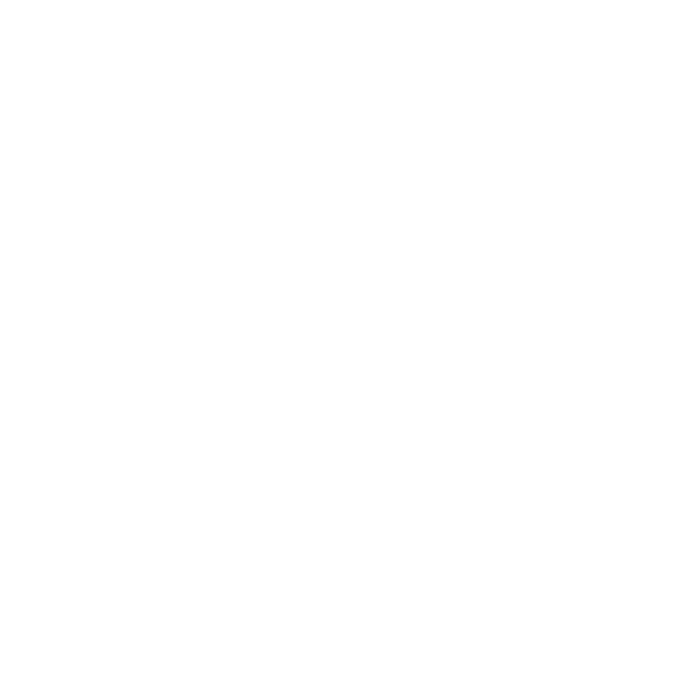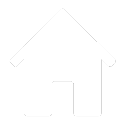L'herpès génital : Symptômes, Transmission et Traitements
L'herpès génital est l’une des infections sexuellement transmissibles (IST) les plus répandues dans le monde. Causée par le virus Herpes simplex (HSV), cette infection est chronique et peut provoquer des poussées récurrentes de lésions douloureuses au niveau des organes génitaux et de la région anale.
Malgré sa forte prévalence, l'herpès génital reste méconnu du grand public, et de nombreux patients ignorent qu'ils sont porteurs du virus. En effet, certains individus sont asymptomatiques ou présentent des manifestations si légères qu’ils ne les associent pas à une IST.
Qu’est-ce que l’herpès génital ?
L'herpès génital est une infection causée par deux types de virus Herpes simplex (HSV) :
- HSV-1, historiquement associé à l’herpès labial (bouton de fièvre), mais qui peut aussi provoquer l'herpès génital via les relations oro-génitales.
- HSV-2, le plus souvent responsable des infections génitales et transmissible par contact sexuel.
Une fois contracté, le virus reste à vie dans l’organisme, logé dans les ganglions nerveux situés près de la colonne vertébrale. Il peut rester en phase de latence pendant des mois, voire des années, avant de se réactiver et de provoquer des symptômes.
Comment se transmet l’herpès génital ?
L'herpès génital se propage par contact direct avec une personne infectée, principalement lors de rapports sexuels (vaginaux, anaux ou oraux).
Modes de transmission du virus HSV
- Rapports sexuels non protégés : l'herpès génital se transmet par contact avec les lésions, mais aussi par simple contact peau à peau, même sans éjaculation.
- Transmission asymptomatique : une personne infectée peut être contagieuse même en l’absence de lésions visibles, notamment lors de la période de réactivation silencieuse du virus.
- Auto-contamination : une personne atteinte d’herpès labial (HSV-1) peut accidentellement propager le virus à la région génitale en touchant une plaie avant de toucher ses parties intimes.
- Transmission de la mère à l’enfant : lors de l’accouchement, si la mère présente une poussée active, l'herpès néonatal peut survenir et causer des complications graves pour le nourrisson.
Facteurs de risque augmentant la transmission
- Rapports sexuels non protégés avec plusieurs partenaires.
- Système immunitaire affaibli (patients atteints du VIH, receveurs de greffe, etc.).
- Contact direct avec des lésions ouvertes.
Présence d’une autre IST, augmentant la sensibilité aux infections virales.
Les symptômes de l’herpès génital
Les symptômes de l'herpès génital varient selon les individus et l’évolution de l’infection. Certaines personnes restent asymptomatiques, tandis que d’autres développent des symptômes marqués lors de la primo-infection et des récidives.
1. Primo-infection : la première poussée herpétique
La première poussée de l'herpès génital apparaît 2 à 12 jours après l’exposition au virus. Elle est souvent la plus sévère, avec :
- Des lésions douloureuses sous forme de vésicules contenant un liquide clair, situées sur les parties génitales, l’anus, les cuisses ou les fesses.
- Des démangeaisons, des brûlures et des douleurs urinaires.
- Des symptômes pseudo-grippaux : fièvre, courbatures, fatigue, ganglions enflés dans l’aine.
Cette première crise peut durer 2 à 4 semaines, le temps que les lésions cicatrisent.
2. Les récidives de l’herpès génital
Une fois la primo-infection passée, le virus entre en phase de latence mais peut se réactiver à tout moment. Les facteurs déclencheurs sont :
- Fatigue et stress
- Changement hormonal (règles, grossesse)
- Fièvre et infections virales
- Exposition prolongée au soleil
Les récidives sont généralement plus courtes (5 à 10 jours) et moins douloureuses que la primo-infection.
Complications du virus HSV
L'herpès génital peut entraîner certaines complications, notamment :
- Un risque accru de contracter le VIH en raison de la fragilisation des muqueuses.
- Une transmission néonatale dangereuse si une femme enceinte a une poussée d’herpès au moment de l’accouchement.
- Des complications neurologiques rares, comme la méningite herpétique.
Diagnostic du virus de l’herpès génital
Le diagnostic repose sur :
- Un examen clinique des lésions par un professionnel de santé.
- Un test PCR (prélèvement des lésions pour identifier l’ADN du virus).
Une sérologie sanguine (recherche des anticorps anti-HSV).
Traitements de l’herpès génital
L'herpès génital ne peut pas être guéri, mais les traitements permettent de soulager les symptômes, de réduire la durée des crises et de limiter la transmission.
1. Traitements antiviraux
Les médicaments les plus couramment prescrits sont :
- Aciclovir (Zovirax®)
- Valaciclovir (Valtrex®)
- Famciclovir
Ces antiviraux sont administrés en traitement ponctuel lors des crises ou en traitement suppressif en cas de récidives fréquentes.
2. Soins complémentaires
- Antalgiques (paracétamol, ibuprofène) pour soulager la douleur.
- Compresses froides et bains tièdes pour apaiser l’inflammation.
Bonne hygiène intime pour éviter la surinfection bactérienne.
Prévention et réduction des risques
1. Utilisation du préservatif
Bien qu’il ne protège pas totalement (le virus peut être sur des zones non couvertes), le préservatif réduit considérablement le risque de transmission.
2. Abstinence en période de poussée
Il est recommandé d’éviter les rapports sexuels en cas de lésions actives.
3. Traitement préventif en cas de récidives fréquentes
Un traitement antiviral au long cours peut être prescrit pour limiter les réactivations et réduire la transmission.
4. Renforcement du système immunitaire
Une bonne alimentation, la gestion du stress et un sommeil suffisant permettent de limiter les récidives.
L'herpès génital est une IST fréquente et chronique, mais bien prise en charge, elle peut être gérée efficacement. Grâce à un diagnostic précoce, un traitement adapté et des mesures de prévention, il est possible de réduire les poussées et de limiter la transmission. Si vous avez des doutes ou présentez des symptômes, il est conseillé de consulter un professionnel de santé et de réaliser un dépistage en laboratoire tel que ceux proposés par Eurofins Biologie Médicale.
Pour en savoir plus :
Pour une compréhension approfondie de l’herpès génital, consultez les pages suivantes :
Complications de l'herpès génital
Transmission de l’herpès génital
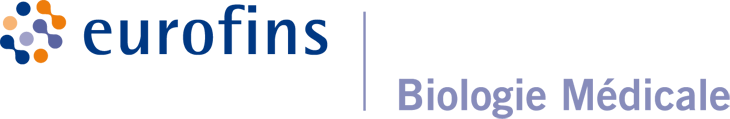
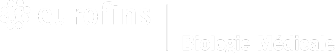
 Patients
Patients
 Professionnels
Professionnels
 Fertilité
Fertilité