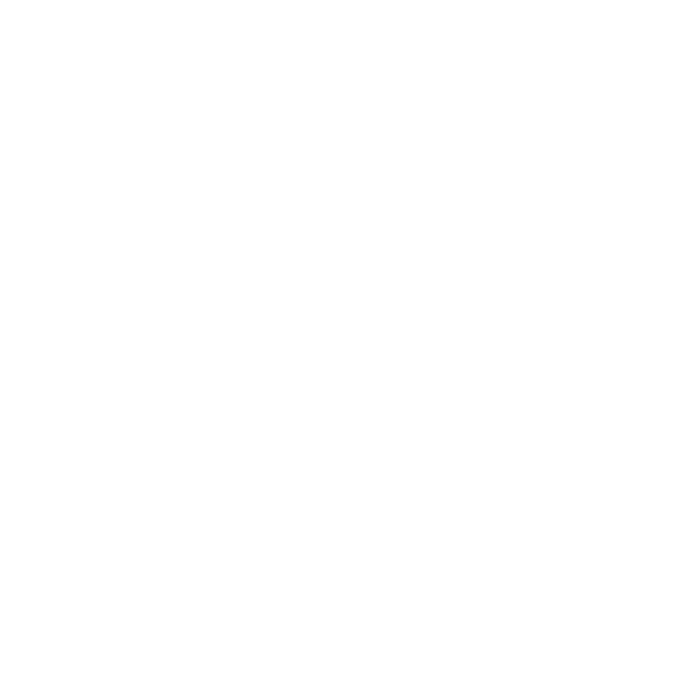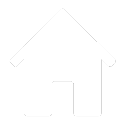Transmission de l’herpès génital : comprendre les modes de contagion pour mieux se protéger
Qu’est-ce que l’herpès génital et pourquoi est-il si contagieux ?
L’herpès génital est une infection sexuellement transmissible (IST) provoquée par le virus Herpes Simplex, principalement de type 2 (HSV-2), bien que le HSV-1 (responsable de l’herpès labial) puisse également être en cause. Cette infection est hautement transmissible, en particulier pendant les poussées symptomatiques, mais aussi en dehors des périodes visibles de symptômes. Le virus se loge dans les ganglions nerveux et peut réapparaître de façon cyclique, ce qui renforce sa capacité à être transmis sans être détecté.
Comment se transmet l’herpès génital ?
Contact direct avec les lésions
Le mode de transmission principal de l’herpès génital est le contact peau à peau avec une personne infectée, notamment au niveau des muqueuses génitales, anales ou buccales. Lorsqu’une personne présente des vésicules ou des plaies herpétiques, le risque de contagion est très élevé.
Transmission en l'absence de symptômes
Une particularité de l’herpès génital est qu’il peut être transmis même sans l’apparition visible de lésions. C’est ce que l’on appelle la « shedding » virale asymptomatique, c’est-à-dire la libération du virus à la surface de la peau sans signes cliniques.
Par quels types de rapports l'herpès génital se transmet-il ?
- Rapports vaginaux : C’est la voie la plus fréquente.
- Rapports anaux : Tout aussi à risque, notamment si des lésions sont présentes.
- Rapports oro-génitaux : Une personne atteinte d’herpès labial (HSV-1) peut transmettre le virus aux organes génitaux de son/sa partenaire.
- Utilisation de sex toys partagés ou mal nettoyés : un vecteur potentiel de transmission indirecte.
Les moments à risque : quand le virus est-il le plus contagieux ?
Durant une poussée symptomatique
Le moment le plus propice à la transmission est lors d’une poussée avec lésions visibles. La peau est alors hautement infectieuse, en particulier si des rapports ont lieu sans protection.
Pendant la phase de shedding
Même sans symptômes, une personne porteuse du virus peut être contagieuse. Cette phase de « shedding » peut durer de quelques jours à plusieurs semaines et passe souvent inaperçue, ce qui explique la forte dissémination du virus.
En cas de primo-infection
Lors de la toute première infection, les charges virales sont particulièrement élevées, rendant le virus extrêmement contagieux. La personne infectée peut ne pas encore connaître son statut, ce qui augmente les risques de transmission de l’herpès génital involontaire.
Les facteurs favorisant la transmission de l’herpès génital
Certaines situations augmentent considérablement le risque de contagion, notamment :
- La présence d'autres IST (chlamydia, VIH, syphilis…)
- Un système immunitaire affaibli
- Des lésions ou des irritations cutanées ou muqueuses
- Une fréquence élevée de rapports sexuels non protégés
- Une absence de traitement antiviral chez la personne porteuse
Transmission de l’herpès génital pendant la grossesse et l’accouchement
Risque pour le nouveau-né
Une femme enceinte porteuse de l’herpès génital peut transmettre le virus à son bébé au moment de l’accouchement, surtout si une poussée est active à ce moment-là. Cette situation peut entraîner un herpès néonatal, une forme grave de la maladie qui peut affecter les organes internes, le cerveau, voire entraîner la mort du nourrisson.
Précautions recommandées
- Un suivi gynécologique rigoureux est essentiel.
- En cas de primo-infection en fin de grossesse, une césarienne est généralement recommandée pour éviter la transmission de l’herpès génital.
- Des traitements antiviraux peuvent être prescrits dès le 8e mois pour réduire les risques de récidive lors de l’accouchement.
Peut-on attraper l’herpès génital autrement que par voie sexuelle ?
Auto-inoculation
Une personne atteinte d’herpès labial peut se transmettre le virus à la zone génitale (ou inversement) en touchant une lésion puis une autre partie de son corps sans se laver les mains.
Transmission indirecte : mythe ou réalité ?
La transmission de l’herpès génital par objets (serviettes, cuvettes de toilettes…) est très rare car le virus survit très peu de temps hors du corps humain. Les contacts indirects sont donc peu à risque, bien que l’hygiène reste primordiale.
Prévention de la transmission de l’herpès génital
Utilisation du préservatif
Le préservatif réduit le risque de transmission, bien qu’il ne protège pas totalement, puisque le virus peut se trouver sur des zones non couvertes.
Traitement suppressif
Pour les personnes avec des récidives fréquentes ou vivant avec un/une partenaire non infecté(e), un traitement antiviral quotidien peut réduire la fréquence des poussées et la transmission du virus de 50 à 90 %.
Communication entre partenaires
Informer son ou sa partenaire de son statut est essentiel pour prendre des décisions éclairées, adopter des comportements préventifs et renforcer la confiance au sein du couple.
Tests de dépistage
Le dépistage de l’herpès génital n’est pas systématique lors des bilans IST. Il peut être proposé en cas de symptômes ou de suspicion, via un prélèvement de lésions ou une prise de sang (sérologie HSV-1/HSV-2).
Ce qu’il faut retenir sur la transmission de l’herpès génital
- Le virus se transmet principalement par contact peau à peau lors de rapports sexuels.
- La transmission de l’herpès génital est possible même sans symptômes visibles.
- Les femmes enceintes doivent faire l’objet d’une attention particulière.
- L’utilisation du préservatif, un traitement antiviral adapté et la bonne communication sont les clés d’une prévention efficace.
- Le virus ne se guérit pas, mais sa transmission peut être largement contrôlée grâce à une bonne prise en charge.
En savoir plus :
Pour une compréhension approfondie de l’herpès génital, consultez les pages suivantes :
Complications de l'herpès génital
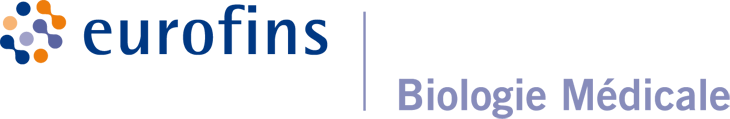
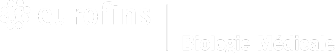
 Patients
Patients
 Professionnels
Professionnels
 Fertilité
Fertilité